La mort
Le vieux tracteur
Le vieux tracteur est mort, pendant l’hiver ;
Aurait cédé quelque joint de culasse
Qu’on ne fabrique plus, ou bien trop cher.
Quoiqu'il en soit, il est bon pour la casse.
Il avait fait son temps et travaillé
Plus d’une vie ; car c’était mon grand-père
Qui l’avait acheté de ses deniers
Quelques années, à peine, après la guerre.
Donc nous l’avons poussé sous le hangar ;
En reculant, cet engin débonnaire
Nous fixait de ses yeux, ronds et hagards,
Et soupçonnait un cas extraordinaire.
Mais en l’abandonnant, j’eus de la peine ;
Il était rouge, ainsi qu’un jouet d’enfant
Et de fabrication américaine ;
Et je l’avais conduit dès mes dix ans.
Il fallait recharger, la veille au soir
Sa batterie, paresseuse et rebelle
Puis lancer son moteur, rempli d’espoir
Le lendemain, à coups de manivelle.
Il toussait et crachait affreusement
Puis démarrait, enfin ! la gorge fière
En faisant ronronner l’échappement.
Mais il grinçait comme un vieux en première.
Alors je l’emmenais dans le verger
Gratter le sable ou, parmi les bruyères,
Débarder quelque tronc. Il fut chargé
Jadis, aussi, de labourer la terre.
Et jusqu’aux derniers jours, puissant encore,
Il avançait, grincheux mais serviteur,
Dans les vastes prairies multicolores
Ou dans les bois qu’apeurait son moteur.
Le vieux tracteur est mort, c’était fatal
Que se rendît cette brave machine ;
Le temps n’épargne rien, ni le métal
Ni notre chair, que nous croyons divine.
La chanson de l’esclave noire
Le grand roi Salomon m’a dit
Alors qu’il partait en voyage
Le lendemain du samedi :
« Serais-je d’humeur si volage ?
Mon temple et mes trésors m’ennuient
Je reçois mille et un hommages
Mais les félicités me fuient.
Mon bonheur manque de nuages. »
L’amour vient de la haine,
Le plaisir de la peine,
La vertu de la peur,
Le repos du labeur.
Le bédouin prophète m’a dit
Alors qu’il était en voyage
Dans les jardins du paradis :
« Je me sens comme un fauve en cage
Dans mon empire d’Arabie.
L’Orient aux mille paysages
Me donne la mélancolie.
Quand donc s’achèvera mon âge ? »
Aux heureux la souffrance,
Aux perdus l’espérance,
La honte aux plus glorieux,
Le doute aux audacieux.
L’illustre Alexandre m’a dit
Alors qu’il était en voyage
Chez un calife de Sidi :
« N’avez-vous point chez vous un mage
Qui parle souvent d’harmonie,
Et qui fabrique des mirages
Qui rendent parfaite la vie ?
Je voudrais rencontrer ce sage. »
Si vous goûtez la rose
Qui vous métamorphose,
Vous oublierez aussi
La joie et le souci.
Si vous goûtez la fleur
Sans bon ni sans mal heur
Vous serez comme un mort
Indifférent au sort.
La ballade de l’égaré
Je recherchais, dans mes jours téméraires,
Le secret du bonheur, tout simplement.
Et je pensais déchiffrer ce mystère
En m’en allant sous d’autres firmaments.
Je partis donc, un jour, gaillardement
Le cœur empli de la belle promesse
D’aller trouver la parfaite liesse.
Je me disais, en défiant le sort :
Il ne se peut que le destin ne laisse
Outre la vie ne trouver que la mort.
Loin des amours, j’ai cherché, solitaire,
A rencontrer le pur contentement ;
Loin des plaisirs et des biens de la terre
Je m’égarais, dans mon entêtement ;
Je refusais, comme font les déments.
De me réjouir, vaincu par ma paresse
Et préférais dépenser ma jeunesse
A pourchasser un fabuleux trésor.
Je me moquais de ceux disant sans cesse
Outre la vie ne trouver que la mort.
Or je voudrais que ce fût à refaire ;
Je n’ai rien connu que mes errements.
Je suis revenu vieux célibataire,
J’ai passé le temps de l’enfantement,
Et des amours j’ai passé le moment.
De mon secret me reste une sagesse :
Qui n’a vécu ne sent d’autre caresse
Que le regret qui le point et le mord.
Et maintenant, à mon tour je confesse
Outre la vie ne trouver que la mort.
Frères ne riez pas de ma détresse
Ni des regrets que pleure ma vieillesse :
Au lieu d’espoir me restent des remords.
Bientôt je vais, si mon âge progresse
Outre la vie ne trouver que la mort.
Le Démon
Dès que je suis bien quelque part, voilà,
Qu’un démon pervers me murmure :
« Cet endroit t’ennuie, va donc au-delà
Changer ta vie à l’aventure... »
Et l’envie de fuir dès lors me torture.
Je tire au hasard ma route, espérant
Rencontrer le bonheur en errant
Où je ne connais ni rien ni personne,
Où ne m’accueille aucun parent ;
Car tout ce que j’aime, je l’abandonne.
En vain, des amis me tendent les bras
Car vraiment je n’ai d’eux pas cure ;
Et je les oublie, comme un fier ingrat,
Comme un méchant et vil parjure ;
Et mon livre d’or est plein de ratures.
Il m’importe peu d’être aussi navrant
Que mon cœur ne soit point assez grand
Ni que quelques-uns quelquefois s’étonnent
Je disparais, indifférent
Car tout ce que j’aime, je l’abandonne.
Mes amours non plus ne m’attachent pas.
J’ai connu quelques femmes sûres
De pouvoir enfin retenir mes pas,
Que j’ai laissées dans la nature,
Sans trop me soucier de leur déchirure.
Car, de me marier, je n’ai pas le cran,
Je me sauve très vite en courant,
Sans doute ai-je peur que l’on m’emprisonne ;
Et je m’en vais quand on me prend
Car tout ce que j’aime, je l’abandonne.
Mes pauvres enfants, je serai très franc,
J’aurai fait un père atterrant
Toujours vagabond, que rien ne raisonne ;
Et, du bonheur, fort ignorant,
Car tout ce que j’aime, je l’abandonne.
Le désarroi
Comment emploierai-je le temps
Et l’âge qui me reste à vivre ?
Deviendrai-je un gai troubadour
Qui se nourrira de son livre
Et mourra jeune mais content ?
Hélas ! J’ai perdu la chanson
Qui parlait de mon espérance
D’être bientôt, pour mon bonheur,
Poète honoré de la France...
Avais-je si peu de raison ?
Ou prendrai-je un métier banal
Pourvoyant à mon ordinaire,
Pour couler de paisibles jours
Comme le font les fonctionnaires
En oubliant mon idéal.
Hélas ! Je n’ai plus de vigueur ;
Tout au long du jour je m’ennuie,
Et je rumine ma langueur.
Je compte les jours qui s’enfuient
Sans même chercher un labeur.
Finirai-je en clochard connu
De toute la ville joyeuse ?
En ivrogne drôle et rôdeur
A la démarche laborieuse,
La face rouge et les pieds nus ?
Mais je n’irai pas jusqu’au bout
De la parfaite déchéance.
Je saurai garder mon honneur
Et plutôt mourir en avance
Que ne plus me tenir debout.
Ou bien je laisserai le sort
Désigner une riche héritière
Que j’épouserai sans pudeur.
Nanti d’une grosse rentière
Je finirai dans le confort.
Hélas ! Je n’ai plus de compagne !
Celle que j’appelais Loulou
M’a jadis arraché le cœur.
Je vis errant comme un vieux loup
Qui hurle seul dans la montagne.
Que les médiocres sont heureux
De s’être donné descendance !
Ils peuvent conjurer la peur
Du néant et de sa béance
En laissant quelqu’un derrière eux.
Hélas ! Où sont tous les enfants,
Les fils que j’aurais voulu faire ?
Je n’ai plus où donner d’amour,
Je n’ai plus ni femme ni mère
Ni de foyer me réchauffant.
Je ne sais pas ce qui m’attend.
Au vent du hasard j’abandonne
La poursuite de mon parcours.
Et, désinvolte, je fredonne :
Comment emploierai-je le temps ?
Le désespoir
Voyez-vous, le désespoir
N’est rien qu’une habitude ;
Il me reste, pour ce soir,
Un souvenir de solitude.
J’ai perdu tous mes désirs.
Je vis célibataire,
Sans amours et sans plaisirs,
En philosophe involontaire.
Sans compagne, sans enfants,
J’achève ma jeunesse ;
Et mon cœur, en s’étouffant,
M’épargnera toute vieillesse.
Dans l’alcool et le tabac
Mes jours, un peu rapides
Dégringolent, pas à pas,
Comme une bourse qui se vide.
Car finira tout cela ;
Un soir, buvant ma bière,
Quelqu’un dira : « Cessez-là
Il faut aller au cimetière. »
Que restera-t-il de moi ?
Des souvenirs, peut-être,
Qui reviendront quelquefois
A ceux qui crurent me connaître.
Puis le voisin ou l’ami
La pensée insouciante,
S’en retournera parmi
Les autres âmes survivantes.
Je serai dans le tombeau,
Carcasse froide et raide ;
Adolescent, j’étais beau
Et ma dépouille sera laide.
Mon dernier et long regret
Sera qu’aucune femme
Ne viendra, dans les cyprès,
Fort inquiète de mon âme,
Me souhaiter la bonne chance,
Belle, les yeux en pleurs,
Et me donner, en silence,
Pour mon voyage, quelques fleurs.
La tristesse
Tu n’aimes pas que je sois triste
Et pourtant, aujourd’hui, je le fus ;
Le chagrin me prit tout à l’improviste,
Dès mon réveil; morne et diffus.
Et la douleur, comme une pluie,
M’accabla tout au long du jour ;
Comme sous le vent l’arbre geint et plie
Je chavirais, l’esprit trop lourd.
Mon cœur voulait que je t’appelle,
Que tu viennes m’aimer tendrement ;
Mais je suis trop fier pour laisser ma belle
Me voir ainsi, faible et dément.
Car je pleurais dans ma détresse,
J’avais mal sans aucune raison ;
Tu m’aurais surpris tombant de faiblesse
Et titubant dans ma maison.
Le soir finit cette souffrance,
Comme passe un mauvais coup de froid ;
Et m’est revenue non pas l’espérance
Mais l’habitude, enfin, je crois,
De vivre seul et d’être un homme
Tourmenté par ses propres démons ;
De mes désespoirs, j’ai perdu la somme,
Et mon chagrin n’a pas de nom.
Cela me prit à l’improviste :
La douleur était à l’affût ;
Toi qui n’aimes pas que je sois bien triste
Ce jour de peine, je le fus.
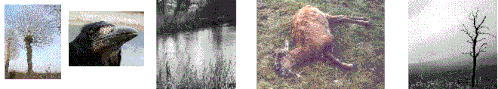
La quarantaine
Dans la forêt, je me promène,
Il fait froid, tout est gris, c’est l’hiver;
J’ai dépassé la quarantaine ;
Tout autour de moi, rien n’est vert.
Les arbres nus, parfois gémissent,
En tordant leurs rameaux hérissés ;
Les feuilles mortes qui pourrissent
Dans la boue vont bientôt s’enfoncer.
Je longe un rang de hideux trognes
- Ce sont de vieux chênes tordus -
Et je rencontre une charogne :
Un oiseau, qui s’était perdu.
Le ciel immense paraît vide,
Un héron, désolé, pousse un cri ;
Ma jambe traîne, un peu rigide,
Une vieille douleur m’a repris.
J’ai dépassé la quarantaine,
Le crachin va tomber sans répit ;
Le vent qui souffle sur la plaine
A fauché les derniers épis.
Les animaux, l’hiver, faiblissent,
Les chevreuils ne mangent plus rien
Et les lapins frileux périssent ;
En passant, je laisse du grain.
Tous les fossés déjà ruissellent
Et la pluie versera de grands flots.
Dans quelques jours les étangs gèlent
Le soleil n’est qu’un pâle falot.
J’ai dépassé la quarantaine
Je me sens presque vieux par instants ;
Dans la forêt, je me promène,
Quand donc reviendra le printemps ?
La vieille
Maintenant que je suis âgée
Souvent me poignent des regrets :
Je regarde mon corps, affligée,
Et je ne crois pas que cela soit vrai ;
Il me semble qu’hier j’étais belle,
La taille mince et le teint frais
Et la gorge voilée de dentelle.
Sur mes jambes nues, mes jupes s’ouvraient.
Mais comment s’est ridée ma face ?
Pourquoi mes seins sont-ils tombés ?
Une vieille m’attend dans la glace
Une affreuse grosse au menton fripé.
Autrefois j’allais à la plage
En bikini, le corps nimbé
D’un peu d’huile, et mon cœur volage
Ne demandait rien que d’être attrapé.
Car j’étais si jolie jeune fille !
J’avais vingt ans et tous les soirs
Je dansais dans les bals où brillent
Les yeux des garçons quand naît leur espoir.
Mes amants me faisaient des promesses,
Et tous les deux, seuls dans le noir,
Nous cherchions à tâtons l’ivresse.
Ils s’en sont allés sans dire au revoir.
Et que sont devenues leurs étreintes ?
Quand, transportée par le plaisir,
J’exultais en poussant des plaintes,
Quand il me semblait que j’allais mourir ?
Maintenant, je suis vieille et laide
L’amour n’est plus qu’un souvenir
Et mes jambes sont lourdes et raides.
Je passe mes jours seule à dépérir.
Et mauvaise devient mon haleine
Ma chair s’en va par grands lambeaux
Je suis sourde et boiteuse et vilaine
Et mon prochain lit sera le tombeau.
Les serpents, paraît-il, souvent muent ;
Je voudrais bien changer de peau
Et renaître fillette ingénue,
Avec un corps neuf, bien plaisant et beau.
Mes amies, de moi fort jalouses
Etaient pourtant jolies aussi ;
J’en avais beaucoup, dix ou douze,
Elles sont parties et je reste ici.
Sans mari, sans enfants et pleureuse,
N’ayant plus rien que des soucis,
Malade, geignarde et honteuse.
Voilà, de ma vie, le triste récit.
La grand peur
Quelquefois le chasseur téméraire s’égare.
Il a tiré, passant soudain, une ombre noire
Et va chercher ce qu’il croit être un sanglier.
Il s’enfonce d’abord dans un vaste hallier,
Puis, déçu, va fouiller, plus loin, d’autres broussailles ;
Il va toujours, prêt à finir cette bataille
Au fond des bois. Mais il ne trouve vraiment rien.
Il n’entend plus les cris des hommes ni des chiens,
Et, finalement, bredouille, il s’arrête.
Il est perdu. Mais cela guère ne l’inquiète.
Il cherche un chemin sous le sombre couvert
Mais tourne en rond dans un réseau de buissons verts.
Il recule au hasard et se heurte à des chênes.
Où donc est-il ? Quels sont ces arbres ? L’âme en peine,
Il continue en remarquant que vient la nuit.
Il soupçonne un danger, il entend quelques bruits,
Il croit voir quelque chose au milieu des vieux saules,
Des ombres le suivent, des griffes le frôlent,
Le cri d’un rapace affole son cœur,
Et fond sur lui, comme une pluie, la grande peur.
Il déraisonne, il hallucine : un écureuil
Est un démon qui veut le mordre et le chevreuil
Qui s’enfuit est un buffle enragé qui le charge !
Et, soudain, il découvre une allée calme et large
Qui conduit au château. Dès lors, il respire.
Il retrouve bientôt le salon et fait rire,
En racontant son aventure de poltron
Tous ses amis, près du foyer, assis en rond.
A la ville aussi, pleine de rumeurs,
Eclôt parfois, dans l’esprit faible, la grand peur.
Il arrive ainsi qu’un grand solitaire
Ne sache plus quel chemin prendre sur la terre.
Est-ce l’âge, déjà, qui corrompt son cerveau ?
Est-ce la vision, brusque, d’un caveau ?
Il se voit soudain, plein de rêves futiles,
Sans amis, sans famille, idiot, inutile ;
Il parle tout seul, dans son bouge obscur,
Il s’adresse au plafond, il questionne les murs,
Et, sans fin, il répète les mêmes histoires,
Les mêmes souvenirs sourdis de sa mémoire.
Il est chagrin, pusillanime et besogneux,
Il se fâche vite, il devient hargneux.
Il lui vient des manies, des phobies, des envies,
Tout se dérègle dans sa laide et triste vie.
Il suffit alors du moindre incident :
Un découvert, une querelle, un mal de dent,
Pour qu’il s’affole, et c’est la peur, c’est la grand peur
Qui l’envahit et qui l’accable de douleurs.
Il croit déjà que des méchants veulent sa ruine,
Ou qu’il a le cancer, que son temps se termine.
Il perd le sommeil, il se ronge, il transpire,
Il voudrait se tuer pour soigner son délire,
Il pleure, il gémit et, finalement,
Il comprend bien, le malheureux, qu’il est dément.
Je voudrais mourir avec ma raison.
Peut-être un peu tôt, peut-être sans gloire,
Mais pouvant toujours dire ma chanson.
Non parmi les fous, pleins de fureurs noires,
Et que l’on enferme dans des prisons,
Mais dans mon pays, au bord de la Loire,
Souffrant, mais avec toute ma raison.
